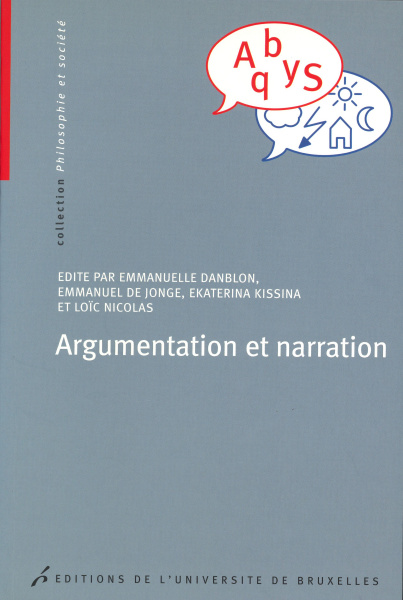Argumentation et narration
Première édition
À travers des contributions de diverses disciplines, cette enquête montre très concrètement que la puissance heuristique de la narration est un levier indispensable à toute pratique de l’argumentation. Elle montre aussi que si les deux registres concourent ensemble à une rationalité pleinement incarnée, ils ne se confondent jamais totalement. Lire la suite
Au cœur de la modernité, il serait vain de discuter le fait que l’argumentation et la narration relèvent de deux registres de discours bien distincts. D’un côté, la narration a pour fonction de représenter des événements, de donner du sens à une situation, de construire un récit auquel une communauté ou un individu peut s’identifier. Ainsi, la narration aurait pour visée première, essentielle, de donner du sens au monde, individuellement ou collectivement. D’un autre côté, l’argumentation est reconnue comme une fonction supérieure du langage, dont la visée complexe est de convaincre ou de persuader autrui, et cela, le plus souvent, en vue de lui faire prendre une décision. Pourtant, au-delà de cette distinction essentielle, les traditions philosophiques, linguistiques mais aussi psychologiques ou juridiques, n’ont jamais manqué d’observer des liens, des interactions et même parfois des rapprochements spectaculaires entre narration et argumentation. Questionner ces liens revient essentiellement à réévaluer notre vision de la rationalité, mise en œuvre par la parole publique. Au-delà d’un clivage figé et, pour tout dire, artificiel entre raison logique et émotions romantiques, se trouve manifestée une raison rhétorique qui sait mettre en récit ses arguments et incarner ses décisions dans l’expérience humaine.
Spécifications
- Éditeur
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Édité par
- Emmanuelle Danblon, Emmanuel De Jonge, Ekaterina Kissina, Loïc Nicolas,
- Introduction de
- Emmanuelle Danblon,
- Contributions de
- Jean-Michel Adam, Julie Allard, Mylène Botbol-Baum, Emmanuelle Danblon, Marc Dominicy, Jean-Claude K. Dupont, Jean-Marc Ferry, Madeleine Frédéric, Ute Heidmann, Thierry Herman, Emmanuel De Jonge, Ekaterina Kissina, Sophie Klimis, Stéphane Leyens, Raphaël Micheli, Loïc Nicolas, François Ost, Evgénia Paparouni,
- Postface de
- Jean-Marc Ferry,
- Langue
- français
- Site web ressource
- Oapen.org
- Catégorie (éditeur)
- > Langue(s) & Littérature(s)
- BISAC Subject Heading
- LAN015000 LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Rhetoric
- Code publique Onix
- 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3080 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Sémantique, analyse du discours, stylistique
Livre broché
- Date de publication
- 25 août 2008
- ISBN-13
- 978-2-8004-1418-8
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 212
- Code interne
- 1418
- Format
- 160 x 240 x 18 cm
- Poids
- 276 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
- Préface | Emmanuelle DANBLON, Emmanuel DE JONGE, Loïc NICOLAS
- Introduction | Emmanuelle DANBLON
- PREMIÈRE PARTIE – Approches politiques Prendre parti ou les stratégies de la rhétorique délibérative
- Énonciation et narration. Fragments de rhétorique chiraquienne | Jean-Michel ADAM
- Narratio et argumentation | Thierry HERMAN
- L'argumentation au secours de la narration et vice versa Étude des préfaces du Dernier Jour d'un condamné | Raphaël MICHELI
- Le récit politique dans le discours de clôture de la présidence luxembourgeoise « Ne pas cacher l’aventure » | Evgénia PAPAROUNI
- DEUXIÈME PARTIE – Approches juridiques. Raconter le droit et penser la norme
- Interprétation, narration et argumentation en droit : le modèle du roman à la chaîne chez Ronald Dworkin | Julie ALLARD
- Établir, qualifier, argumenter : le « fait » et le « droit » à la Cour européenne des droits de l’homme | Jean-Claude K. DUPONT
- Le préambule des déclarations des droits de l’homme : entre narration et argumentation | Emmanuel DE JONGE
- TROISIÈME PARTIE – Approches littéraires. Le récit comme argumentation
- Le mauvais exemple et l’« art d’écrire entre les lignes » | Marc DOMINICY
- Témoignages de guerre et méandres génériques : la guerre de 14 selon Barbusse et Cendrars | Madeleine FRÉDÉRIC
- Narration et argumentation dans Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre de Perrault et Cenerentola de Buzzati | Ute HEIDMANN
- À tort et à l’envers : Sade ou l’écriture travestie | François OST
- QUATRIÈME PARTIE – Approches philosophiques Raison discursive : origines et actualité
- La pluralité des modes d’argumentation du discours bioéthique : entre pragmatisme et recherche d’objectivité du jugement | Mylène BOTBOL-BAUM
- La nécessaire articulation de l’argumentation avec la narration. Les vertus d’un modèle « inférentialiste » de la rationalité | Stéphane LEYENS
- Narration et argumentation en Grèce ancienne | Sophie KLIMIS
- Postface. Registres de discours, identité, normativité | Jean-Marc FERRY
- Liste des auteurs