Stravinski et ses exégètes
(1910-1940)
First Edition
La musique de Stravinski fascine autant qu’elle dérange. Entre 1910 et 1940, le compositeur incarne le renouveau autant que le Rappel à l’ordre. Read More
Peu à peu, les musicologues posent les jalons d’une exégèse, article après article, livre après livre. Le compositeur mène l’intrigue : l’approche qu’il a eue de ces jugements comporte une radicalité qui l’a incité à concevoir les adversaires comme des ennemis et les partisans comme des apologistes. Les principaux commentateurs "autorisés" de l’art de Stravinski ont été ses plus proches collaborateurs, ses amis, ses fidèles défenseurs et serviteurs. Ses éminences grises ? À travers la quête de justesse dans laquelle le compositeur s’implique, c’est la puissance suggestive du mythe qui se dévoile.
C’est aussi une histoire de foi et une recherche d’éternité. L’image que Stravinski désire laisser de lui-même fait aussi partie intégrante de son art : façonner une icône culturelle et en faire une œuvre d’art.
Specifications
- Publisher
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Author
- Valérie Dufour,
- Language
- French
- Supporting Website
- Oapen.org
- Publisher Category
- Publishers own classification > Art(s) & Archeology
- Publisher Category
- Publishers own classification > History
- BISAC Subject Heading
- MUS050000 MUSIC / Individual Composer & Musician
- Onix Audience Codes
- 06 Professional and scholarly
- CLIL (Version 2013-2019)
- 3667 ARTS ET BEAUX LIVRES
- Subject Scheme Identifier Code
- Thema subject category: Composers and songwriters
Paperback
- Publication Date
- 04 April 2019
- ISBN-13
- 978-2-8004-1638-0
- Extent
- Main content page count : 216, Content page count : 216
- Code
- 1638
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
ePub
- Product Detail
- 1
- Publication Date
- 04 April 2019
- ISBN-13
- 978-2-8004-1654-0
- Product Content
- Text (eye-readable)
- Extent
- Main content page count : 216
- Code
- 1654
- Epub Accessibility
- Table of contents navigation, Index navigation
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
Liste des sigles et des abréviations
Introduction
L'émergence d'un nouveau champ : les études migratoires queer
La fabrique d'une nouvelle catégorie de réfugié·es
Européanisation et trajectoires nationales
Catégorisation migratoire et instrumentation de l'action publique
Une traduction multiniveau inscrite dans un temps long
Une comparaison transnationale et processuelle
Organisation des chapitres
Chapitre I - La catégorie de « réfugié·es LGBTI » à l'échelon supranational
La genèse de la catégorie de « réfugié·e LGBTI » au sein du HCR
Les réfugié·es LGBTI dans le cadre des persécutions liées au genre
Les réfugié·es LGBTI dans le cadre de l'« appartenance à un certain groupe social »
La stabilisation de la catégorie de « réfugié·e LGBTI » à travers le régime international des droits humains
La lutte contre les discriminations et la protection des réfugié·es LGBTI à l'échelon international
L'émergence d'un nouvel échelon : les réfugié·es LGBTI au seil du Conseil de l'Europe
Le verrouillage de la catégorie de « réfugié·e LGBTI » et la volonté d'harmonisation
L'opérationnalisation de la protection des réfugié·es LGBTI à l'échelon international
La vulnérabilisation des réfugié·es LGBTI au sein de l'Union européenne
Conclusion
Chapitre II - La Belgique : droits humains et solidarité internationale
Genèse (1995-2001) : l'influence du Haut Commissariat pour les réfugiés sur le CGRA
Stabilisation (2002-2009) : expertise interne et autonomie du CGRA
Verrouillage (2010+) : mainstreaming et harmonisation des pratiques
Conclusion
Chapitre III - La France : les réfugié·es LGBTI, plus vulnérables que les autres
Genèse (1995-2010) : entre perception sociale et visibilité sociale
Stabilisation (2011-2013) : un rapprochement entre l'ARDHIS et l'OFPRA
Verrouillage (2014+) : la vulnérabilisation des réfugié·es LGBTI au sein de l'OFPRA
Conclusion
Chapitre IV - Le Royaume-Uni : la sexualité renvoyée au placard
Genèse (1989-1999) : les demandeurs d'asile OSIG en tant que groupe social particulier
Stabilisation (2000-2010) : dissimuler son homosexualilté pour échapper aux persécutions
Verrouillage (2011+) : évaluer la crédibilité à partir de stéréotypes
Conclusion
Chapitre V - Trois trajectoires nationales de la traduction
Les logiques interprétatives à travers le paradigme de traduction
La définition du problème
La solution politique
L'univers de discours
Les logiques positionnelles à travers la configuration des arènes de traduction
L'arène administrative
L'insularité administrative
La structure organisationnelle de l'autorité asilaire
L'arène associative
La disponibilité des ressources
Le répertoire d'action
L'arène judiciaire
Les sources du droit
L'influence de la juridiction d'appel sur l'autorité administrative
Conclusion
Trois trajectoires nationales
Implications empiriques et analytiques
Inclure pour exclure ?
Annexe - Liste des entretions
Références bibliographiques

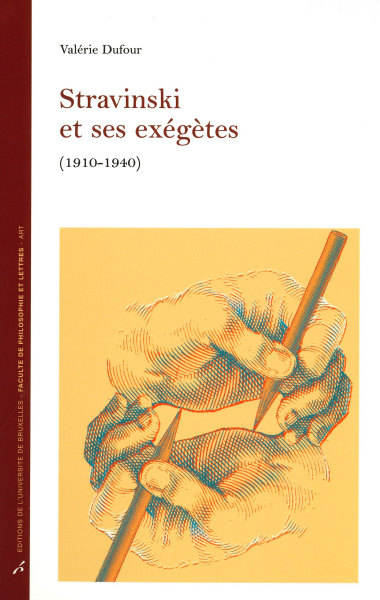
Review