Le traité instituant l'Union européenne : un projet, une méthode, un agenda
Second Edition
Le 14 février 1984, le Parlement européen adoptait à une très large majorité un projet de traité d'Union européenne, dont Altiero Spinelli avait été l’inspirateur et le rapporteur-coordinateur. L’Institut d’Etudes européennes de l’ULB a entendu s’associer à la célébration de cet événement par la publication du présent ouvrage. Read More
Ce volume reprend le texte du Commentaire article par article dû aux quatre juristes qui ont assisté le Parlement dans l'élaboration du projet, les professeurs Francesco Capotorti, Meinhard Hilf, Francis Jacobs et Jean-Paul Jacqué, et publié en 1985 dans les collections de l’Institut. Cette réédition a été complétée par des textes qui soulignent les apports du projet Spinelli dans le développement constitutionnel de l’Union européenne.
En effet, trente ans après son adoption, il se confirme que, comme le soulignaient les auteurs de la première édition, l’intérêt du projet Spinelli allait bien au-delà de l’actualité immédiate car il avait conduit les parlementaires à réfléchir à plusieurs questions essentielles : nature des compétences exercées par la future Union, approfondissement de celles-ci, place des droits de l’homme dans la construction européenne, amélioration du processus de décision, rapprochement de l’activité communautaire et de la coopération politique, développement du rôle de la Cour de justice. L’initiative du Parlement européen a aussi ouvert la voie à un processus de mise à jour des traités de Rome qui, en près de trente ans, malgré l’importance des bouleversements sur la scène internationale et dans la société européenne n’avaient pas connu de modification substantielle. Ses apports positifs à l’Acte unique européen et aux traités de Maastricht, Amsterdam, Nice et, après l’échec du traité constitutionnel, de Lisbonne sont indéniables. Certes, la technique des petits pas constitutionnels a été suivie, à l’inverse de l’approche du projet de 1984, mais celui-ci a été une source puissante d’inspiration dans l’affirmation des principes et des méthodes de l’intégration européenne, qu’il s’agisse, par exemple, du remplacement de la coopération intergouvernementale par l’action commune ou du renforcement de la démocratie dans la procédure de décision.
Enfin, le projet Spinelli n’explique pas seulement le passé de la construction institutionnelle de l’Union européenne. Il comporte des enseignements pour l’avenir. Par sa méthode d’élaboration d’abord : le projet émane du Parlement européen, fort de la légitimité démocratique que lui octroyait l’élection au suffrage universel de 1979. Pour Spinelli, le projet s’adressait d’abord aux parlements nationaux. Par sa portée constitutionnelle et les modalités originales de reprise de l’acquis communautaire ainsi que par la confiance faite aux institutions, ensuite. Par sa procédure d’entrée en vigueur, enfin. Il s’agit là d’autant de leçons à méditer notamment et au premier chef par le Parlement européen élu en mai 2014 et auquel le traité de Lisbonne de 1997 accorde, pour la première fois, le pouvoir de proposer une révision des traités constitutifs.
Specifications
- Publisher
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Edition
- 2
- Editorial coordination by
- Marianne Dony, Jean-Victor Louis,
- Author
- Francesco Capotorti, Meinhard Hilf, Francis Jacobs, Jean-Paul Jacqué,
- Preface by
- Jean-Paul Jacqué, Jean-Victor Louis,
- Afterword by
- Giorgio Napolitano,
- Foreword by
- Pierre Pfimlin,
- Contributions by
- Altiero Spinelli,
- Collection
- European Studies | n° 55
- ISSN
- 13780352
- Language
- French
- Publisher Category
- Publishers own classification > Law
- BISAC Subject Heading
- LAW004000 LAW / Annotations & Citations
- Onix Audience Codes
- 06 Professional and scholarly
- CLIL (Version 2013-2019)
- 3259 DROIT
- Subject Scheme Identifier Code
- Thema subject category: Constitutional and administrative law: general
Paperback
- Publication Date
- 17 February 2014
- ISBN-13
- 978-2-8004-1557-4
- Extent
- Main content page count : 432
- Code
- 1557
- Dimensions
- 210 x 300 x 20 cm
- Weight
- 1352 grams
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
- Avant-propos épistémologique
- CHAPITRE I : La mesure de la répartition de la richesse et du développement économique
- 1. Les concepts : valeurs ajoutées, produit et revenu intérieurs, revenu national
1. La valeur ajoutée
2. Le produit intérieur et le revenu national - 2. Lacunes et difficultés d'interprétation de la mesure du produit
1. Les lacunes de la comptabilisation
2. La difficulté des comparaisons internationales
3. Revenu, consommation, investissement
4. L'impact de l'évolution des modes de régulation sur l’utilisation du produit :
l’exemple de la Belgique
5. La dispersion des revenus - 3. Les inégalités de la répartition de la richesse dans le monde, dans les logiques de
l’économie dominante - 4. Des indicateurs alternatifs
1. L’indice de développement humain (IDH)
2. La prise en compte de la soutenabilité environnementale
3. Conclusion : aucun indicateur n’est neutre - 5. Structure du produit et développement
1. Centre et périphérie dans le contexte de la division mondiale du travail
2. Les caractéristiques structurelles des pays développés
1. La précocité de l’industrialisation
2. La tertiarisation de l’économie contemporaine
3. Des niveaux intersectoriels de productivité assez similaires
3. La désarticulation de l’économie dans les pays de la périphérie
1. Les insuffisances de la productivité agricole
2. Les développements industriel récents - 6. Au-delà des valeurs nationales : inégalités et structures régionales
1. Les disparités régionales
2. Le développement se lit aussi dans les structures spatiales - 7. Conclusion : face au centre, l’unité dans la diversité de la périphérie
- CHAPITRE II : La mise en place d’un monde plus inégal
- 1. Les temps longs de la mise en place des disparités mondiales
- 2. Des déterminismes des conditions naturelles aux « mentalités » favorables
- 3. Développement et démographie
1. Densités de population et développement économique
2. Croissances démographiques et développement en Europe
3. La transition démographique dans les pays de la périphérie
1. Croissance démographique et investissement dans les pays périphériques
2. Les implications économiques des croissances démographiques des pays
de la périphérie dans le cadre de leur articulation dominée par l’économie
mondiale
4. Conclusions
- CHAPITRE III : Aux origines de la suprématie économique : Europe, États-Unis, Japon
- 1. L’Europe, foyer originel du système-monde
1. L’exception féodale européenne
2. Accumulation du capital et conditions préalables au démarrage
1. L’abondance monétaire et la pratique du crédit dans des conditions non usuraires
2. Un capital humain réceptif au progrès
3. L’affaiblissement des structures politiques et institutionnelles liées aux rapports
de production féodaux et à la petite production marchande corporative
4. La monétarisation croissante de la ponction des surplus, l’unification des marchés
et la disparition des régulations locales dans le cadre de la formation des États royaux
mercantilistes, puis des États-nations
5. La formation de surplus agraires
6. Une accélération de la croissance démographique
3. Le Portugal et l’Espagne : accumulation précoce sans développement
4. L’Europe du nord-ouest, foyer initial de la révolution industrielle
1. Les Pays-Bas se cantonnent dans le capitalisme marchand et bancaire
2. L’Angleterre connaît la première révolution industrielle
3. Le démarrage plus tardif et plus lent de la France
4. L’Allemagne : un démarrage tardif mais vigoureux, s’appuyant sur une forte
concentration du capital et en liaison avec une politique impérialiste de l’État
5. L’italie, un développement tardif et dichotomique
6. La Russie : d’une situation périphérique et d’une accumulation exogène à une tentative
brutale d’édification du socialisme dans un seul pays, aux dépens d’une agriculture
archaïque
7. Conclusions - 2. Les États-Unis : une projection extra-européenne du modèle capitaliste anglo-saxon
- 3. Le Japon : un démarrage industriel endogène en dehors du contexte sociétal européen
1. Un milieu insulaire apte à accueillir la riziculture
2. De la féodalité à la rénovation Meiji
3. L’imbrication étroite des groupes dominants et de l’appareil d’État
4. La croissance rapide des trois décennies de l’après-guerre - 4. Conclusions
- CHAPITRE IV : Les étapes de la formation et de la spatialité de l’économie-monde
- 1. La période de l’impérialisme mercantile : de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle
1. La formation d’une périphérie européenne
2. Les périphéries d’Outre-mer dans l’économie-monde mercantiliste
1. Les plantations tropicales, en particulier sucrières : commerce triangulaire et
traite des esclaves
2. La colonisation précoce des grands Empires précolombiens
3. Les escales asiatiques pour le commerce colonial des produits artisanaux coûteux
et des épices
3. Les colonies tempérées précocement émancipées, bases d’un futur autre centre
4. Les poussées aventurières sur les « frontières » - 2. Les cycles de l’économie mondiale à partir de la révolution industrielle
- 3. L’essor de l’impérialisme et du colonialisme
1. Les modes de régulation dans le centre durant les trois premiers Kondratieff
2. L’intérêt renouvelé pour les colonies durant le deuxième Kondratieff
1. Un certain désintérêt pour les colonies durant la phase A du deuxième cycle de
Kondratieff
2. La montée des trusts et l’intérêt renouvelé pour les Empires coloniaux durant la
phase B du deuxième Kondratieff
3. La recherche de matières premières agricoles exotiques ou minérales
a. Le pillage
b. Le travail indigène forcé ou sa mobilisation par la capitation
c. Le développement des cultures d’exportation tropicales
d. Les économies minières d’enclave
e. Exportation de matières premières et insertion des périphéries : les conséquences
des spécialisations primo-exportatrices
4. Les conséquences différentes des spécialisations primo-exportatrices dans les
régions tempérées
5. La recherche de marchés et d’opportunités de placement de capitaux en périphérie
et l’étouffement des industrie locales
a. Du colonialisme mercantiliste au colonialisme impérialiste, les mutations de la
colonisation britannique en Inde
b. L’absence de développement industriel en Chine : un colonialisme
sans colonisation
c. L’échec des tentatives d’industrialisation de Mehemet Ali en Egypte
6. Conclusions - 4. Les tentatives d’industrialisation endogène dans la périphérie en situation contre-cyclique
ou en rupture autarcique par rapport à l’économie-monde durant le troisième Kondratieff
1. Une tentative d’industrialisation endogène coupée de l’économie-monde : l’Union
soviétique
2. L’Inde et la Chine
3. L’Amérique latine : tentatives d’industrialisation de substitution d’importation en
situation contre-cyclique - 5. Après la Seconde Guerre mondiale, la rupture fordiste et keynésienne de la phase A
du quatrième Kondratieff
1. Le fordisme dans le centre : une croissance sans précédent, jusqu’à la crise pétrolière
1. La surcapacité de l’économie américaine et la situation politique en Europe
2. Un rôle accru de l’État et un contexte de forte croissance salariale
3. Progrès technologiques et organisation scientifique du travail
4. La mécanisation de l’agriculture et la baisse de prix de ses produits
5. Les nouvelles institutions financières internationales
2. La situation dans la périphérie
1. La décolonisation et le recentrage des économies du centre
2. La perte d’importance relative pour le centre des matières premières produites par
la périphérie et la détérioration tendancielle de leurs termes de l’échange - 6. La mise en place d’un régime d’accumulation néolibéral à partir de la fin des
années soixante-dix
1. La crise du fordisme et la transition de la seconde moitié des
années soixante-dix dans le centre
2. Le virage néolibéral de la fin des années soixante-dix
3. Des performances contrastées au centre
4. Les conséquences du virage néolibéral en périphérie
1. A l’origine du virage néolibéral en périphérie : la crise de la dette
2. Une instabilité chronique, des performances contrastées
3. Une macro-géographie du post-fordisme en périphérie
a. Les NPI asiatiques
b. La Chine
c. L’Inde
d. L’Amérique latine
e. L’Afrique
f. Les pays pétroliers
g. L’ancien bloc soviétique
5. Les relations économiques internationales : la mondialisation libérale
1. Une géographie du commerce mondial
a. L’essor du commerce mondial
b. La géographie des flux commerciaux
c. Commerce international et division mondiale du travail
d. Les théories confrontées à l’empirie
2. Les investissements directs étrangers : le recentrage et l’expansion des
investissements transnationaux depuis la Seconde Guerre mondiale
3. La géographie des flux financiers
6. Conclusion - 7. Conclusions générales : l’évolution de l’économie-monde, du mercantilisme à aujourd’hui
- Listes des figures et tableaux
- Liste des figures
Liste des tableaux

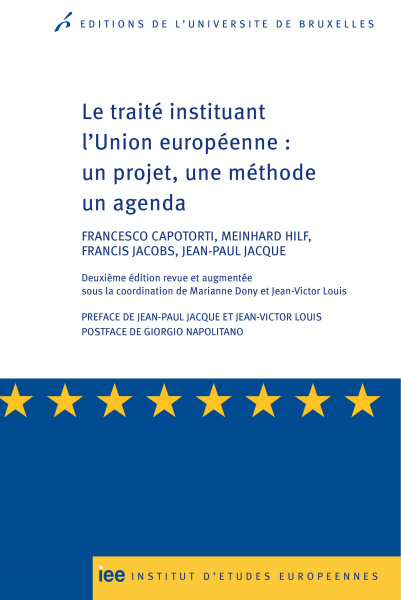
Review