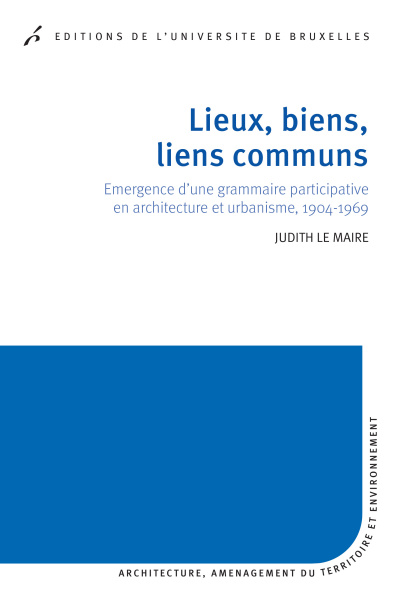Lieux, biens, liens communs
Émergence d'une grammaire participative en architecture et urbanisme, 1904-1969
First Edition
Judith le Maire livre une « grammaire » de la participation en architecture et urbanisme et révèle les principales figures d’architectes et urbanistes « participationnistes ». Read More
Si les années soixante-dix et la fin du XXe siècle montrent une intense pratique participative en architecture et urbanisme, aucun ouvrage ne l’origine au tournant des XIXe et XXe siècles. Avec l’urbanisme, des pratiques et des écrits mobilisent la participation des citoyens, notamment ceux de Patrick Geddes. Luttant contre le « super-taudis », le père fascinant des « machines à penser » et des « tours observatoires » est aussi celui de filiations d’architectes participationnistes : des membres du Team Ten, L. Kroll… Il est de plus l’inspirateur de penseurs, comme son disciple L. Mumford, grand théoricien de la ville. Ou d’« entrepreneurs », tel P. Otlet, le fondateur de la classification décimale universelle, qui, captivé par son « exposition de ville », commande à V. Bourgeois un urbaneum pour Bruxelles en support à la participation urbaine.
S’appuyant sur la figure inaugurale de Geddes, l’ouvrage décline la « grammaire » de la participation en architecture et urbanisme. A partir d’une réflexion sur ses outils, ses acteurs et ses formes, se dégagent alors des figures d’architectes et urbanistes « participationnistes ». À côté des maîtres, tel Le Corbusier qui s’exclame « participation ! » dès 1932, l’ouvrage conduit vers des pédagogues comme L. Kahn, qui interroge les citoyens du New Deal : « Why city planning is your responsibility », ou G. De Carlo qui rallie à l’esthétique brutaliste les participants à la construction d’un village italien. L’horizon de la participation éclaire l’histoire de l’architecture afin de mieux saisir comment, du CIAM de 1947 au Team Ten, deux voies se séparent, l’une vers le processus participatif et l’autre vers l’objet architectural.
Cette « grammaire » jette un regard nouveau sur l’engouement participatif d’aujourd’hui et précise le flou qui entoure le terme de « participation ». Le point de vue des architectes et des urbanistes enrichit la question de leur rôle social et politique ainsi que le débat sur l’esthétique architecturale.
Specifications
- Publisher
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Author
- Judith le Maire,
- Collection
- Territories, Environment, Societies | n° 6
- ISSN
- 25066722
- Language
- French
- Supporting Website
- Oapen.org
- Publisher Category
- Publishers own classification > Architecture
- Publisher Category
- Publishers own classification > Art(s) & Archeology
- BISAC Subject Heading
- ARC010000 ARCHITECTURE / Urban & Land Use Planning
- Onix Audience Codes
- 06 Professional and scholarly
- CLIL (Version 2013-2019)
- 3080 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES
- Subject Scheme Identifier Code
- Thema subject category: Architecture
Livre broché
- Publication Date
- 20 February 2025
- ISBN-13
- 978-2-8004-1900-8
- Extent
- Absolute page count : 221
- Legal Copyright Date
- D/2024/0171/24 Bruxelles, Belgium
- Code
- 1900
- Dimensions
- 16 x 24 x 1.2 cm
- Weight
- 445 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
Avant-propos
En guise de préambule : le cas Nodier
Valérie André
Introduction - Genre romanesque et esprit du temps (1800-1830)
Nicolas Duriau
Chapitre 1 - Poétiques/Critiques de l'écriture
L'écriture du réel dans l'oeuvre de Pigault-Lebrun
Shelly Charles
Emotional Verisimilitude and Fictional Illusion in the Early Nineteenth-Century Novel - Responses to Claire de Duras's Édouard (1825)
Stacie Allan
Questions de poétique romanesque dans la presse française autour des publications de Mme de Genlis - 1800 et 1808
Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
Chapitre 2 - Formes, thèmes et clichés
Représentations de la religion - Le Roman du Début du XIXe Siècle
Fabienne Bercegol
Entre Arcadie et Pacifique, la Suisse comme lieu romanesque
Claire Jaquier
Cécile, ou les passions (1827) d'Étienne de Jouy - Observation, roman épistolaire et récit de cas
Bénédicte Prot
Un garçon pour le trottoir - Prostitution, pédérastie et travestissement dans L'enfant du bordel (1800)
Nicolas Duriau
Youthful Balzac, Balzac's Youths - Falthurne and la Comédie humaine
Polly Dickson
Chapitre 3 - Mises en récit de l'histoire
Felicie et Florestine (1803) de Polier de Bottens, un roman révolutionné
Catriona Seth
« Tout est vraisemblable, et tout est romanesque dans la Révolution de la France » - Les réécritures gothiques de la Révolution française, 1800-1820
Fanny Lacôte
The Works of Sophie Cottin - Regenerating the Nation Through the Feminine and the "Other"
Christie Margrave
Bibliographie sélective
Index des noms
Personalia