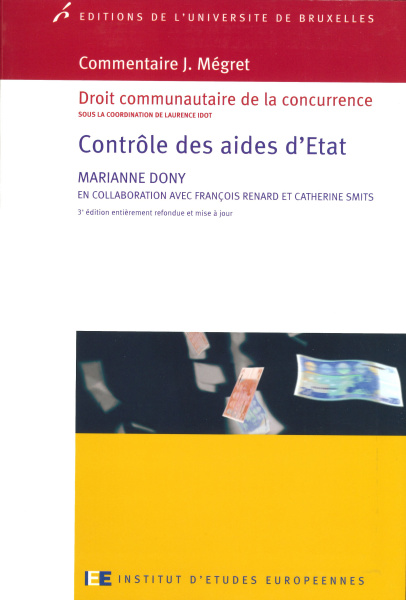Contrôle des aides d’État
3e édition
Cet ouvrage analyse le contrôle des aides d’État au niveau communautaire, qui est à un tournant de son existence, avec la mise en œuvre du plan d’action dans le domaine des aides d’État adopté par la Commission européenne en juin 2005 Lire la suite
Grande matière "Droit communautaire de la concurrence", sous la coordination de Laurence Idot, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et vice-présidente de l'Association française d'étude de la concurrence.
Deuxième volume paraissant dans le cadre de la troisième édition du Commentaire J. Mégret, – et tome 3 de la grande matière consacrée à la concurrence –, cet ouvrage traite du contrôle des aides d’État au niveau communautaire. Ce contrôle est actuellement à un moment crucial de son existence avec la mise en œuvre du plan d’action dans le domaine des aides d’État adopté par la Commission européenne en juin 2005. Ce plan l’a fait entrer dans le champ de la modernisation du droit de la concurrence, avec un léger retard sur le droit antitrust et le droit des concentrations. Les maîtres mots de la réforme engagée dans ce domaine sont : place plus grande accordée à l’analyse économique, – jusqu’à présent très largement absente en la matière – ; des aides moins nombreuses, mais mieux ciblées sur des objectifs prioritaires ; et ébauche d’une certaine décentralisation avec un rôle renforcé des juridictions nationales. L’heure était donc particulièrement bienvenue d’une analyse de cette matière.
Selon un plan désormais classique, la première partie de l’ouvrage est consacrée aux règles de fond applicables aux aides d’État, contenues à l’article 87 CE. Le premier chapitre livre une présentation approfondie des critères qui définissent la notion d’aide d’État au sens de cette disposition, avec un accent mis sur deux problématiques qui ont suscité difficultés et débats : le critère de l’opérateur en économie de marché et la compensation des obligations de service public. Le second chapitre traite des dérogations au principe de l’interdiction des aides d’État, dont l’importance n’est plus à démontrer puisqu’elles concernent en définitive l’immense majorité des aides. L’octroi des dérogations relève largement du pouvoir d’appréciation de la Commission, sous le contrôle des juridictions communautaires. Le lecteur trouvera une analyse systématique de la pratique de la Commission, telle qu’elle s’est déclinée au fil de l’examen des différents cas qui lui étaient soumis, pour se trouver ensuite codifiée, d’abord officieusement dans des orientations et autres lignes directes, et ensuite officiellement dans les règlements d’exemption que la Commission s’est vue habilitée à adopter par le Conseil.
Les règles de procédure, inscrites à l’article 88 CE, font l’objet de la deuxième partie du présent ouvrage. Pendant de longues années, à défaut de tout texte de mise en œuvre de l’article 88 CE, les contours de la procédure de contrôle des aides ont été définis par la pratique de la Commission et la jurisprudence des juridictions communautaires. Le règlement de procédure, adopté par le Conseil en 1999, est venu confirmer ces règles, qui sont décrites en détail dans un premier chapitre, articulé sur la distinction fondamentale entre le contrôle a priori des nouvelles et l'examen permanent des aides existantes. Le dernier chapitre, quant à lui, est consacré aux recours juridictionnels. Deux aspects ont plus particulièrement retenu l'attention : d'une part, l'articulation des rôles respectifs des juridictions nationales et communautaires ; d'autre part, les recours ouverts aux différentes parties intéressées à l'égard des prises de position – ou leur absence – de la Commission.
Sur ces différentes questions, l'ouvrage entend mettre en lumière les enjeux, faire le point sur l'état du droit applicable, relever les lacunes persistantes et proposer les pistes pour éventuellement y remédier. Il est le fruit d'une collaboration d'une académique avec des praticiens, tous trois éminents spécialistes de la matière.
Spécifications
- Éditeur
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Édition
- 3
- Auteur
- Marianne Dony,
- Avec
- François Renard, Catherine Smits,
- Coordination éditoriale de
- Laurence Idot,
- Collection
- Commentaire J. Mégret | n° 15
- ISSN
- 20330197
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- > Droit
- BISAC Subject Heading
- LAW098000 LAW / Practical Guides
- Code publique Onix
- 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3259 DROIT
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Droit : guides d’étude et de révision
Paperback
- Date de publication
- 28 août 2007
- ISBN-13
- 978-2-8004-1395-2
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 288
- Code interne
- 1395
- Format
- 160 x 240 x 23 cm
- Poids
- 525 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
- Préface | Michelle PERROT
- Introduction – Choisir l'histoire des femmes ! | Régine BEAUTHIER,
Catherine JACQUES et Valérie PIETTE
- PREMIÈRE PARTIE – Femmes et sciences
- Créer. Hier et aujourd'hui. Les femmes et les sciences
- Variations nationales
Premières interrogations
Les femmes hors de la raison
Le XIXe siècle ou le triomphe du sexisme
Le mythe de l’objectivité
Conclusion
- Marie Curie et le radium : l’information et la légende en Belgique
- Heurts et malheurs de l’information scientifique
Un test : les Conseils de physique Solvay
Une information sporadique et progressivement déviée
Le décès de Marie Curie
Images et mirages : les étapes d’une légende
Des images contradictoires
Un modèle pour manuels de morale
« A fine stimulant for the heart »
- Histoire des femmes, histoire de genre
- De l’histoire sociale…
… à l’histoire des femmes
Pas de sources pour les femmes ?
L’événement et le non-événement
La périodisation, trame de l’histoire
Le genre
Pour conclure : de nouvelles perspectives ?
- De l’histoire des femmes aux études de genre
- De l’histoire militante à l’histoire scientifique ou la découverte du « continent noir »
La grande déception de mai 68
Du « positivisme de l’urgence » à la théorisation
Des apports spécifiques ou des progrès pour l’histoire en général ?
Le genre : une voie de garage pour l’histoire des femmes ?
Histoire des femmes, histoire du genre, histoire des hommes…
Conclusion
- DEUXIÈME PARTIE – Femmes dans l’espace public
- Genre et citoyenneté en Belgique. 1885-1921
- Une citoyenneté à deux vitesses
Le féminisme laïque à l’épreuve du suffrage
Le contexte intellectuel et politique
Les influences intellectuelles
L’évolution de la lutte des partis
Conclusion : un suffrage qui conforte la construction des genres
- Les femmes et la citoyenneté politique en Belgique L’histoire d’un malentendu
- Le citoyen de 1831 : un homme qui possède
1850-1880 : l’égalité par l’éducation ?
1890-1914 : le détournement politique du féminisme
Le bilan du « long XIXe siècle »
Le vote communal, une première avancée ?
Conclusions
- Le suffrage féminin en Belgique (1830-1921). Arguments et enjeux
- Electeurs, électrices : un parcours et des enjeux différents
Un premier obstacle : les discours masculins
L’électorat au XIXe siècle : une fonction et non un droit
Pratiques et discours féminins
Conclusions
- Libéralisme, féminisme et enseignement des filles en Belgique au XIXe
et au début du XXe siècle - De l’intérêt des regards croisés
Un premier préalable : les mots
Deuxième préalable : les contenus
Une réflexion féministe précoce et structurée (1830-1850)
L’indispensable rencontre avec le libéralisme
Conclusions
- TROISIÈME PARTIE – Discours, modèles et représentations
- Vivre seule au XIXe siècle. Une approche historique
- Femmes seules, femmes mariées : la tyrannie de la minorité
Etat, condition, trajectoires : les causes de la solitude et le regard de la société
Solitudes involontaires, solitudes sous influence, solitudes sous contrôle
Les célibataires
Les veuves
Les divorcées
Femmes de condamnés, femmes condammées
Conclusions
- Le modèle de la femme au foyer en Belgique avant 1914
- La femme au foyer : un paramètre de la question sociale
L’éducation, garante de l’ordre social
Un jugement révisé en fonction des luttes politiques
La question scolaire
Le débat sur la réglementation du travail des femmes et des enfants
Les écoles ménagères : une solution à la question sociale ?
Un modèle « opérationnel » après les émeutes de 1886
Un relais important : les Congrès des Œuvres sociales à Liège
Un concept à géométrie variable
Apprentissage ou mission « naturelle » ?
L’interprétation patronale
L’interprétation ouvrière
Un réseau d’enseignement ménager à partir de 1889
Les objectifs de l’enseignement ménager
Conclusion
- Les paysannes belges aux XIXe-XXe siècles
- Les mal aimées de l’histoire des femmes
L’occultation économique : un travail toujours mal comptabilisé
Des effectifs toujours sous-estimés
Une réalité concrète : l’indispensable labeur des paysannes
Organiser et encadrer les femmes rurales
La prise en charge du politique : la Société d’Economie sociale
Un tournant : « Le rôle social de la fermière »
Former les jeunes filles : l’enseignement ménager agricole
Encadrer les adultes : les Cercles de Fermières
L’entre-deux-guerres : bis repetita
La double mission des femmes rurales
Maintenir la foi et les traditions familiales
Conclusions
- QUATRIÈME PARTIE – Femmes et guerre (1914-1918)
- Réflexions sur genre et guerre en Belgique (1914-1918)
- La situation particulière de la Belgique
Les conditions de travail
Des changements de mentalité ?
Conclusions
- La symbolique de la souffrance. Les infirmières en 1914-1918
- Une guerre à laquelle on ne voulut pas croire
L’intervention de la Croix-Rouge
La confusion indescriptible des débuts
Partout des soignantes…
La maîtrise des nurses anglo-saxonnes
Silhouettes étonnantes
Une réorganisation systématique
En Belgique occupée
Aux confins du mythe : l’infirmière du front
L’Ambulance de l’Océan ou le creuset anglais du nursing belge
Statut et rémunération des infirmières
Des tensions internes
Infirmières et soldats
Dans la tradition catholique : l’hôpital Sainte-Elisabeth à Poperinghe
Conclusions
- La résistance des femmes en Belgique occupée (1914-1918)
- Introduction
Une guerre qui interfère dans les rapports sociaux de sexes
Les femmes et les réseaux de résistance
Les motivations de l’engagement féminin
La question des sources
Un patriotisme semblable à celui des hommes
Le désir d’agir
Allier foi et patriotisme
« Nature » féminine et compassion maternelle
Se réaliser
La lutte contre la « barbarie »
Une activité rémunératrice
Des engagements récurrents
Conclusions
- Bibliographie