« Signer la déportation »
Migrations africaines et retours volontaires depuis le Maroc
Première édition
Au Maroc, des migrants africains décident de « signer la déportation », c'est-à-dire de rentrer au pays par le biais d'une aide au retour volontaire de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Lire la suite
Comment les migrants en viennent-ils à rentrer au pays par le biais d'un retour « volontaire » ? Quels sont les acteurs qui les encouragent à aller dans ce sens ? Et comment s'organise l’éloignement sur le terrain ? Dans son ouvrage, Anissa Maâ adopte les outils de la sociologie et de l’anthropologie pour appréhender les programmes d’aide au retour volontaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). À partir d’une enquête ethnographique conduite au Maroc auprès de migrants africains et des acteurs qui les assistent au quotidien, l’autrice démontre que les retours volontaires se façonnent à l’intersection de la violence des frontières, de pratiques locales d’intermédiation et de la capacité d’action des migrants qui, selon leurs propres termes, « signent la déportation ». L’ouvrage dévoile alors toute la complexité d’un instrument de contrôle migratoire qui demeure trop souvent réduit à une forme dissimulée d’expulsion ou promu comme seule alternative possible dans un contexte de fermeture des frontières.
Spécifications
- Éditeur
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Auteur
- Anissa Maâ,
- Collection
- Sociologie et anthropologie | n° 20
- ISSN
- 25935895
- Langue
- français
- Mots clés
- Afrique subsaharienne, contrôle migratoire, humanitaire, Maroc, migrants, migration, OIM, Organisation internationale pour les migrations
- Catégorie (éditeur)
- > Sociologie & Anthropologie
- BISAC Subject Heading
- POL048000 POLITICAL SCIENCE / Intergovernmental Organizations > SOC007000 SOCIAL SCIENCE / Emigration & Immigration > SOC066000 SOCIAL SCIENCE / Refugees > POL053000 POLITICAL SCIENCE / World / African
- BIC subject category (UK)
- J Society & social sciences > JH Sociology & anthropology > JHM Anthropology > JHB Sociology
- Dewey (abrégé)
- 300-399 Social sciences > 300 Social sciences, sociology & anthropology > 301 Sociology & anthropology
- Code publique Onix
- 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3080 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES > 3091 Migrations et immigrations
- Date de première publication du titre
- 25 janvier 2024
- Type d'ouvrage
- Monographie
- Avec
- Bibliographie, Bibliographie, Appendices, Appendices, Notes, Notes
Livre broché
- Details de produit
- 1
- Date de publication
- 25 janvier 2024
- ISBN-13
- 978-2-8004-1805-6
- Ampleur
- Nombre de pages numérotées : 192
- Code interne
- 1805
- Format
- 16 x 24 x 11 cm
- Poids
- 382 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
ePub
- Details de produit
- 1
- Date de publication
- 29 janvier 2024
- ISBN-13
- 978-2-8004-1806-3
- Contenu du produit
- Text (eye-readable)
- Ampleur
- Nombre absolu de pages : 192
- Code interne
- 1806
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Remerciements
Préface
Introduction
L'éloignement « pour le bénéfice de tous »
Les retours volontaires depuis le Maroc
Cadre d'analyse
Chapitre I – Violence
Violence des frontières
Contingence du retour
Chapitre II – Intermédiation
L'information contre les migrations
Intermédiation humanitaire
Chapitre III – Intermédiation indigène
Des intermédiaires migrants
Racialisation de l'intermédiation
Position ambivalente
Pratiques contrastées
Chapitre IV – Agencéité migrante
Demander le retour
Incertitude du retour
Se retourner
Conclusion

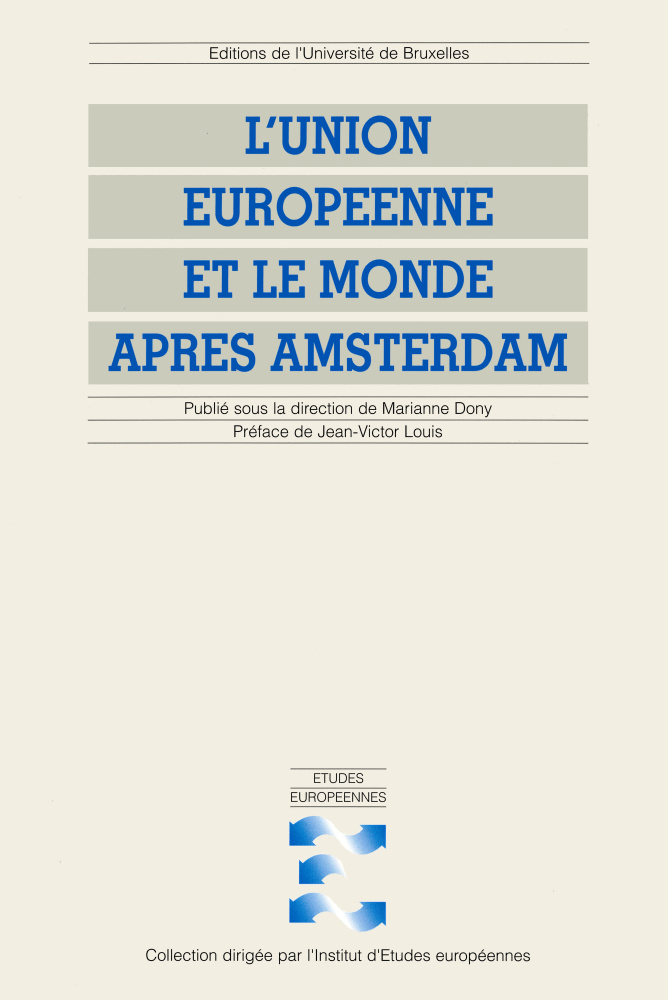
The Conversation - Les intermédiaires « pairs », ces migrants recrutés pour dissuader leurs compatriotes de venir en Europe