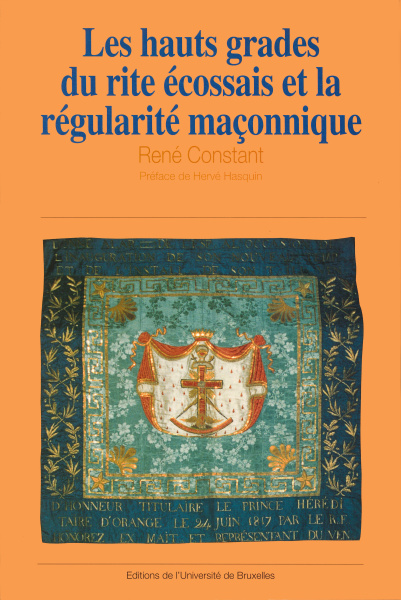Les hauts grades du rite écossais ancien et accepté et la régularité maçonnique
(Belgique, Pays-Bas, grand-duché de Luxembourg)
Première édition
Rédigé par un scientifique et maçon expérimenté, ce livre ne laissera personne indifférent car il allie la rigueur de l’homme de science à l’expérience du praticien. Lire la suite
La franc-maçonnerie fait recette. Chaque année voit une nouvelle floraison de livres. Hélas, la médiocrité et l’apologie côtoient bien souvent l’anecdote ou le dénigrement. Au total, nombre de ces ouvrages où se mêlent le vrai et le faux, les faits et la légende, contribuent un peu plus à entretenir autour de la maçonnerie, de son histoire, de sa finalité, un brouillard qui ne peut satisfaire le lecteur à l’esprit critique un tant soit peu aiguisé. À l’évidence, dans l’abondante littérature consacrée à la maçonnerie, il n’existe encore que trop peu de livres à l’information rigoureusement établie, ne serait-ce que parce qu’elle émane fréquemment de non-maçons auxquels des sources de première importance sont restées inaccessibles.
Dans ce contexte, le livre de René Constant mérite de sortir de l’anonymat. L’auteur est un scientifique doublé d’un maçon expérimenté qui a connu de l’intérieur les trois principales obédiences masculines qui se sont implantées successivement en Belgique ; il a en outre joué un rôle déterminant dans l’histoire de la Grande Loge régulière et dans celle du Suprême Conseil (dit régulier) de Belgique. S’ajoutent à cela une connaissance sans égale des instances maçonniques internationales qui se considèrent comme régulières et en particulier sa maîtrise des questions les plus actuelles qui se posent aux États-Unis. En conséquence, l’ouvrage de René Constant s’écarte résolument de la grisaille dans laquelle se confondent la plupart des publications de maçons, ou de non-maçons sur ces problèmes complexes… et passionnels que sont la « régularité maçonnique » et les hauts grades du rite écossais ancien et accepté. Nombre de maçons membres des obédiences proches du CLIPSAS ne partageront pas les vues de l’auteur, mais là n’est pas l’essentiel. René Constant a en effet le mérite d’établir sans ambiguïté, de son point de vue de « maçon régulier », la ligne de partage qui sépare la maçonnerie libérale et latine d’Europe continentale de la maçonnerie d’obédience anglo-saxonne qui prétend à la régularité.
Spécifications
- Éditeur
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Auteur
- René Constant,
- Préface de
- Hervé Hasquin,
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- > Histoire
- Catégorie (éditeur)
- > Sociologie & Anthropologie
- BISAC Subject Heading
- SOC038000 SOCIAL SCIENCE / Freemasonry & Secret Societies
- Code publique Onix
- 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3375 Sociétés secrètes
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Sociétés secrètes
Livre broché
- Date de publication
- 20 février 2025
- ISBN-13
- 978-2-8004-1900-8
- Ampleur
- Nombre absolu de pages : 221
- Dépôt Légal
- D/2024/0171/24 Bruxelles, Belgique
- Code interne
- 1900
- Format
- 16 x 24 x 1,2 cm
- Poids
- 445 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Avant-propos
En guise de préambule : le cas Nodier
Valérie André
Introduction - Genre romanesque et esprit du temps (1800-1830)
Nicolas Duriau
Chapitre 1 - Poétiques/Critiques de l'écriture
L'écriture du réel dans l'oeuvre de Pigault-Lebrun
Shelly Charles
Emotional Verisimilitude and Fictional Illusion in the Early Nineteenth-Century Novel - Responses to Claire de Duras's Édouard (1825)
Stacie Allan
Questions de poétique romanesque dans la presse française autour des publications de Mme de Genlis - 1800 et 1808
Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval
Chapitre 2 - Formes, thèmes et clichés
Représentations de la religion - Le Roman du Début du XIXe Siècle
Fabienne Bercegol
Entre Arcadie et Pacifique, la Suisse comme lieu romanesque
Claire Jaquier
Cécile, ou les passions (1827) d'Étienne de Jouy - Observation, roman épistolaire et récit de cas
Bénédicte Prot
Un garçon pour le trottoir - Prostitution, pédérastie et travestissement dans L'enfant du bordel (1800)
Nicolas Duriau
Youthful Balzac, Balzac's Youths - Falthurne and la Comédie humaine
Polly Dickson
Chapitre 3 - Mises en récit de l'histoire
Felicie et Florestine (1803) de Polier de Bottens, un roman révolutionné
Catriona Seth
« Tout est vraisemblable, et tout est romanesque dans la Révolution de la France » - Les réécritures gothiques de la Révolution française, 1800-1820
Fanny Lacôte
The Works of Sophie Cottin - Regenerating the Nation Through the Feminine and the "Other"
Christie Margrave
Bibliographie sélective
Index des noms
Personalia