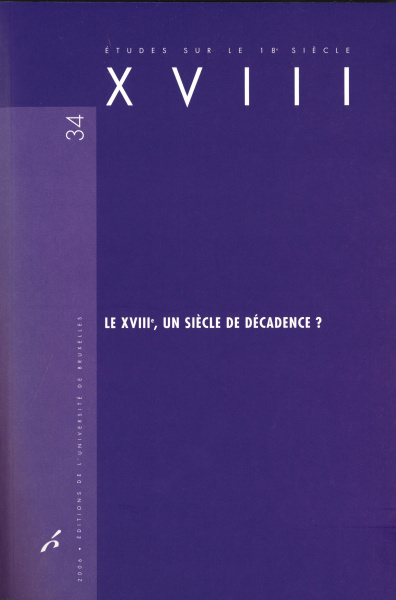Le XVIIIe, un siècle de décadence ?
Première édition
Alors que le dix-huitème siècle est souvent associé à l'optimisme des Lumières, les auteurs de ce volume ont voulu exposer sa face « décadente » affectant tous les domaines de la vie sociale et anticipant des bouleversements majeurs. Lire la suite
Sans doute peu de lecteurs du XXIe siècle répondraient-ils positivement à la question posée en tête de ce volume. Et le fait même de la formuler pourra paraître incongru à certains.
Ce serait ignorer, cependant, qu'en plein siècle des Lumières, de nombreuses voix se sont élevées afin de mettre en doute les progrès dont on se targuait généralement dans les différents domaines de la connaissance, des arts, ou de la littérature. Et ces voix n’émanaient pas que des anti-Philosophes, loin de là ! Dans le camp philosophique lui-même, en effet, les plus grands auteurs – Rousseau, bien sûr, mais aussi Voltaire ou Montesquieu, par exemple – n’ont pas manqué de comparer défavorablement leur propre époque aux précédentes, jugées plus fastes, plus sages, ou comme ayant fait preuve d’un goût plus sûr. L’Antiquité, cela va sans dire, se taille la part du lion dans ces flatteuses appréciations, mais aussi, notamment, un XVIIe siècle que l’éclat du Roi-Soleil nimbe encore d’un énorme prestige.
Tour à tour, tous les domaines de la vie sociale sont passés au crible par les censeurs des turpitudes du siècle : décadence des mœurs et de l’art de gouverner, laxisme des couvents, recul de la musique religieuse « inspirée » devant un art désormais voué au seul plaisir, vogue dangereuse du « trop facile » roman, utopies aventureuses menaçant l’ordre social, etc. Face à ce constat plutôt inquiétant, nombreux sont les auteurs qui finissent par se résigner à imputer aux "lois de l’histoire", ou même parfois à celles de l’évolution de l’espèce humaine, cette "décadence" somme toute inévitable puisqu’elle se trouve en germe dans tous les apogées. On se convainc par conséquent, en lisant ce volume, que derrière le masque optimiste des Lumières et le rêve qu’elles portent d’un avenir meilleur, les hommes du dix-huitième siècle pressentaient avec acuité, mais non sans trouble, l’approche d’une impasse sociétale qui allait bientôt conduire aux bouleversements que l’on sait.
Entre nostalgie d’un passé déjà révolu et anticipations audacieuses d’un futur encore espéré, la tension était manifestement devenue trop forte. À l’appel du Groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université libre de Bruxelles, une quinzaine de chercheurs belges, français et italiens se sont penchés sur ce thème, sans doute trop peu étudié jusqu’à présent.
Spécifications
- Éditeur
- Éditions de l'Université de Bruxelles
- Édité par
- Valérie André, Bruno Bernard,
- Préface de
- Valérie André,
- Contributions de
- Valérie André, Benoît De Baere, Thierry Favier, Andrea Gatti, Jan Herman, Nathalie Kremer, Tanguy L'Aminot, Christophe Loir, Didier Masseau, Fabrice Preyat, Alexandre Stroev, Sylvie Thorel-Cailleteau, Olivier Vanderhaeghen, Christophe Van Staen, Laurent Versini, Maria Giuseppina Vitali-Volant,
- Revue
- Études sur le XVIIIe siècle | n° 24
- ISSN
- 07721358
- Langue
- français
- Site web ressource
- Oapen.org
- Catégorie (éditeur)
- > Histoire
- Catégorie (éditeur)
- > Langue(s) & Littérature(s)
- BISAC Subject Heading
- HIS037050 HISTORY / Modern / 18th Century
- Code publique Onix
- 06 Professionnel et académique
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3377 HISTOIRE
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Histoire de l’Europe
Livre broché
- Date de publication
- 17 janvier 2005
- ISBN-13
- 978-2-8004-1348-8
- Ampleur
- Main content page count : 648
- Code interne
- 1348
- Format
- 160 x 240 x 30 cm
- Poids
- 1219 grammes
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
- Introduction
- PREMIÈRE PARTIE. PROBLÈMES GÉNRAUX
- Chapitre I. La personnalité juridique internationale de la Communauté et de l’Union européenne
Introduction : l’attribution de la personnalité
I. Les relations diplomatiques de la Communauté
II. Le droit d’ester en justice
III. La responsabilité internationale
IV. La personnalité juridique internationale de l’Union européenne.
- Chapitre II. Les compétences de la CE de conclure des accords
I. La compétence expresse de la CE
II. La compétence implicite
III. La situation résultant de la jurisprudence de la Cour
- Chapitre III. La procédure de conclusion des accords internationaux
Introduction
I. Les origines de l’article 300 et son évolution
II. Les différentes phases de la procédure
III. La participation du Parlement européen au déroulement de la procédure de négociation et de conclusion des accords : une démocratisation difficilement négociée
IV. La portée des accords conclus pour les États membres
- Chapitre IV. L’insertion des accords dans l’ordre juridique de la Communauté et des États membres
Introduction
I. L’effet direct des accords internationaux
II. Le cas particulier du GATT et de l’OMC
III. La primauté des accords internationaux sur le droit dérivé.
- Chapitre V. Le contrôle juridictionnel des accords internationaux
I. Le contrôle préventif
II. Le contrôle a posteriori
- Chapitre VI. Les accords mixtes
I. Les causes de la mixité
II. Les conséquences de la mixité
- Chapitre VII. Les accords antérieurs conclus par les États membres et le droit communautaire
- DEUXIÈME PARTIE. LES PRINCIPAUX TYPES D’ACCORDS INTERNATIONAUX
- Chapitre I. La politique commerciale commune et les accords commerciaux
Introduction
I. L’étendue des compétences communautaires : conflits de compétences et conflits de bases juridiques
II. La nature des compétences communautaires : une nouvelle ligne de partage avec les États membres
- Chapitre II. Les accords d’association
Introduction
I. Les limites du texte de l’article 310 CE
II. L’utilisation des articles 238 CEE et 310 CE dans la pratique
III. Le contenu des principaux accords d’association conclus par la Communauté
IV. Les institutions et le droit de l’association
- Chapitre III. Les accords conclus au titre des deuxième et troisième piliers
- TROISIÈME PARTIE. LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LA PARTICIPATION À CELLES-CI
- Introduction
- Chapitre I. La participation aux organisations internationales, une question majeure abordée de manière lacunaire par les traités communautaires
I. Des enjeux majeurs
II. Des traités souvent lacunaires
- Chapitre II. Le statut de la Communauté européenne au sein des organisations internationales
I. Le caractère encore exceptionnel de la participation de la Communauté en tant que membre à part entière d’une organisation internationale
II. La situation plus habituelle d’observateur accordée à la Communauté au sein des organisations internationales
- Chapitre III. Des modalités de participation souvent délicates à déterminer au plan interne
I. La représentation externe de « l’entité européenne »
II. La mise au point des positions à défendre au sein des enceintes internationales
III. L’exécution des engagements pris au sein des enceintes internationales
- QUATRIÈME PARTIE. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE. L’IDENTITÉ EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
- Chapitre I. Les caractéristiques fondamentales de la politique étrangère et de sécurité commune
I. Les origines de la PESC
II. Les liens entre la PESC et les autres piliers de l’Union européenne
- Chapitre II. Les mécanismes de la PESC
I. La prise de décision
II. La mise en œuvre des instruments
III. Le financement de la PESC
IV. Le contrôle démocratique et juridictionnel
V. La personnalité juridique de l’Union
VI. Les rapports entre la PESC et la politique étrangère des États membres
- Chapitre III Les questions relatives à la sécurité de l’Union
I. Le cadre institutionnel des traités
II. La politique européenne de sécurité et de défense
- Chapitre IV. Les réalisations de la PESC
I. La diplomatie déclarative
II. La diplomatie programmatique
III. La diplomatie coercitive
IV. La diplomatie préventive
V. La diplomatie positive
VI. La diplomatie de riposte
- Chapitre V. Les dispositions du traité constitutionnel en matière de politique étrangère
I. La structure du traité
II. Les dispositions institutionnelles
III. La représentation extérieure de l’Union européenne
IV. La capacité contractuelle
V. La politique étrangère et de sécurité commune
VI. La politique de sécurité et de défense commune
- Conclusion. Les relations extérieures dans le traité constitutionnel